Accueil > Coopération. Solidarité > La loi Oudin-Santini : quand ses principaux promoteurs en parlent.
La loi Oudin-Santini : quand ses principaux promoteurs en parlent.
vendredi 20 décembre 2013, par
La loi Oudin-Santini, un moyen de compléter la conquête de marchés par les grands groupes français de l’eau sous couvert de solidarité... affabulation d’écologistes ?
Laissons parler, pour en juger, les principaux promoteurs de la loi.
Séance du 22 juin 2004 au Sénat.
A l’ordre du jour : un débat sur ce qui deviendra la loi Oudin-Santini.
M. Charles Guené, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
"Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, présentée par M. Jacques Oudin et plusieurs de nos collègues de la commission des lois, a pour objet de permettre à ces collectivités et établissements d’apporter une contribution, d’une part, à l’effort de solidarité de la France envers les pays les plus démunis et, d’autre part, à la diffusion d’un modèle de gestion de l’eau et de savoir-faire reconnu dans le monde entier. "
M. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie.
"Ce texte permettra, me semble-t-il, tout à la fois de valoriser l’expertise française dans le domaine de l’eau et d’offrir aux acteurs engagés dans ce processus de coopération décentralisée le cadre juridique qui leur faisait défaut.
C’est également une manière intelligente et généreuse de favoriser l’essor de nos entreprises en Afrique, tout en assurant une meilleure sensibilisation de nos populations aux questions de développement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.) "
26 janvier 2005 à l’Assemblée.
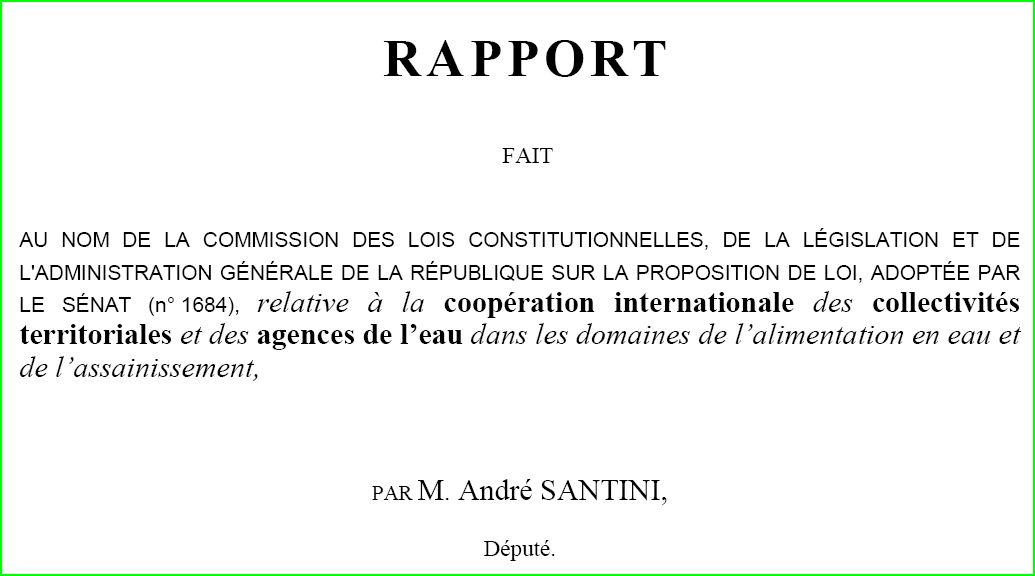
André Santini page 11 du rapport :
" donner aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, la possibilité de conclure des conventions de coopération internationale, est non seulement un moyen de permettre une exportation du modèle français de gestion de l’eau, mais aussi un moyen de compléter utilement la conquête de marchés par les grands groupes français ."
M. Christian Decocq
" a tout d’abord observé que la coopération internationale des collectivités territoriales dans le domaine de l’alimentation en eau constituait une modalité de la mondialisation qui devait être encouragée. Il a indiqué qu’il existait une véritable « école de l’eau » française, faisant montre d’un grand savoir-faire en matière d’exploitation de cette ressource naturelle, qui était malheureusement insuffisamment valorisée et exportée en dehors de nos frontières."
M. Jérôme Lambert
"a, à son tour, souligné la grande maîtrise technique des entreprises et des collectivités territoriales françaises en matière d’assainissement et d’exploitation de l’eau et émis le souhait que ce savoir-faire soit davantage valorisé afin de renforcer sa contribution à la croissance économique."
"Pompe à fric" pour certaines grosses "ONG"... encore une affabulation ?
Cercle français de l’eau.
"Où en sommes-nous, deux ans et demi après le vote de la loi Oudin Santini ?"
Jean LAPEGUE, Action contre la Faim, p17.
"Je peux également ajouter, de notre point de vue d’opérateur de terrain et d’ONG, ce en quoi la loi Oudin-Santini est utile par rapport à nos bailleurs classiques. Action contre la Faim est une ONG qui fait de l’eau depuis vingt-cinq ans nous avons trente trois millions d’euro par an de projets en eau dans vingt-un pays et le volume moyen d’un projet tourne autour du million d’euro.
Les acteurs, loi Oudin-Santini, qui travaillent avec nous contribuent en moyenne de cinquante à cent mille euro par an. A première vue on peut dire que c’est finalement très petit par rapport à notre budget global car cela ne représente qu’un million d’euro sur trente-trois. En même temps cela a d’énormes avantages car la plupart des bailleurs institutionnels, je pense à l’Union Européenne, travaille en cofinancement.
Très souvent le fait d’obtenir un cofinancement de type loi Oudin-Santini, même s’il est à la hauteur de cent mille euro, va déclencher un grand bailleur institutionnel et donc nous allons pouvoir monter un nouveau projet."
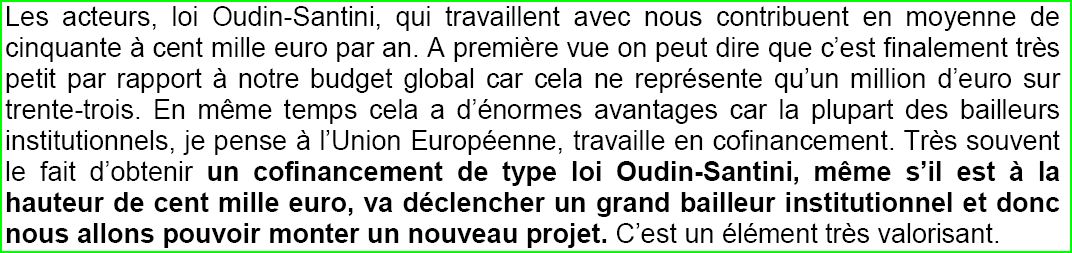
La loi "Houdin" (sic) pour exporter le modèle français ? Qui le propose ?
RAPPORT D’INFORMATION sur « La géopolitique de l’eau »
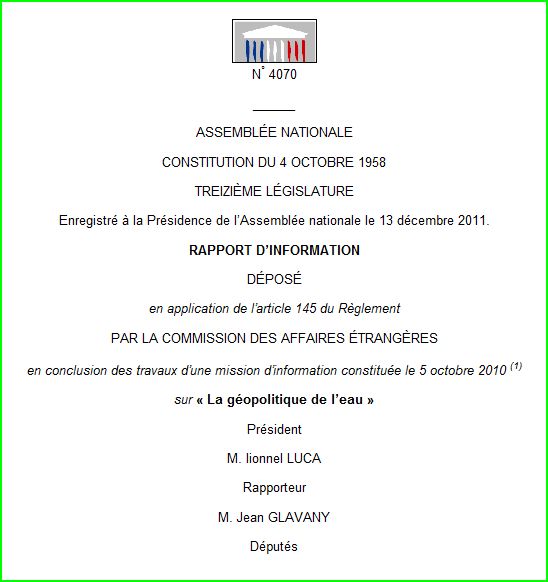
M. Jean-Paul Bacquet.
" Nous ne savons pas exporter suffisamment la délégation de service public.
Il faut en finir avec le cliché qui veut que la gestion publique de l’eau serait par nature économe tandis que la gestion privée coûterait chère. Tout dépend de la capacité des responsables politiques à s’investir sur cette question. Les délégataires peuvent s’acquitter correctement de leur tâche. Si certains contrats de délégation ont été dénoncés, c’est parce que le travail n’était pas fait et que le délégataire s’était assuré l’indulgence des élus.
Il faut réhabiliter la délégation de service public dont nous avons tort de ne pas exploiter le potentiel extraordinaire à l’étranger . "
M. Jean Glavany, rapporteur.
" Le modèle français est exportable sur plusieurs aspects : que ce soit les modalités de la délégation de service public, la technologie des entreprises, ou encore la décentralisation et la gestion par des agences de bassin. Je partage le sentiment de Jean-Paul Bacquet sur la question de la gratuité : elle n’existe pas, il y a toujours quelqu’un qui paie. Quant à la coopération décentralisée : la loi Houdin (sic) est mise en œuvre par certaines agences de bassin, mais il faudrait structurer ces initiatives dans un cadre global. Le ministère y réfléchit ."
M. Lionnel Luca, président.
" Je suis tout à fait d’accord avec Jean Glavany. Il y a effectivement un savoir-faire français dont nous n’avons pas à rougir et qu’il faut savoir exporter. Les entreprises y gagnent, mais le pays aussi. C’est un bénéfice pour tout le monde.
Il ne faut pas oublier qu’il y a concurrence sur ces questions, avec les Etats-Unis et bientôt la Chine. Nous avons tout intérêt à soutenir nos entreprises, qui interviennent dans un esprit qui n’est pas uniquement mercantile. Nous avons rencontré de nombreux interlocuteurs dans cette logique. Vous trouverez dans le rapport des éléments plus exhaustifs et plus précis. Ce rapport pourrait aussi être vu comme une bonne synthèse du sujet avant la tenue du Forum mondial de l’eau à Marseille l’an prochain."
Après l’eau, voir aussi le 1% énergie
Voir aussi sur le site de Marc Laimé :
Marseille/Fragments (10)
par Marc Laimé, 27 mars 2012
Avec l’instrumentalisation du « Droit à l’eau », que nous avons déjà chroniquée, la grande affaire de ce forum (raté), les deux allant de pair comme on va le voir, fut la tentative (avortée) de faire adopter le « 1% Oudin-Santini », autre exception française, par l’Europe, voire la planète entière… Tentative qui dessine impitoyablement les fondements de l’idéologie française en matière d’aide publique au développement dans le domaine de l’eau : la charité avec l’argent des autres, pour vendre la "marque" France…
Voulez-vous une dernière perle ?
Elle est de Oudin, il nous explique, lors d’un colloque au "cercle français de l’eau", pourquoi les "gros opérateurs" que sont les grands syndicats des eaux comme le SEDIF, le SIAAP, les Agences de l’Eau, les grandes villes, peuvent plus facilement piocher dans l’argent de l’eau pour leurs opérations de "mécénat humanitaire" :
"Les gros opérateurs d’eau sont plus facilement mobilisables.
Le contrôle démocratique est un peu plus éloigné. Le citoyen n’a guère son mot à dire.
Plus la collectivité est petite plus les questions se posent et la résistance des habitants ou des consommateurs d’eau peut être plus forte."
Faut-il être encore plus clair ?

