Accueil > France d’Outremer > Pesticides aux Antilles : G. Borvon témoigne.
Pesticides aux Antilles : G. Borvon témoigne.
mercredi 6 mai 2020, par
Depuis 2003, Gérard Borvon a travaillé sur les conséquences de l’utilisation massive du chlordécone, un pesticide résistant, dans les plantations de bananes aux Antilles.
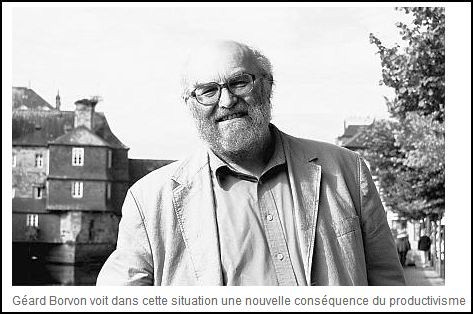
le télégramme Publié le 20 septembre 2007
Depuis 2003, Gérard Borvon a travaillé sur les conséquences de l’utilisation massive du chlordécone, un pesticide résistant, dans les plantations de bananes aux Antilles. Il témoigne.
Le rapport du cancérologue Dominique Belpomme vient de faire l’actualité. En tant que membre du comité national de l’eau où il siège depuis dix ans au titre de président de l’association S-eau-S, Gérard Borvon en sait long sur ce dossier.
Comment avez-vous été alerté ?
Des représentants de la Guadeloupe étaient venus, en 2003, décrire leur situation au comité qui a un rôle consultatif sur toutes les directives-cadres européennes. J’ignorais cette pollution dramatique. Je me suis aperçu qu’il y avait pire que le cas breton. Un rapport avait été remis en 2001 à Dominique Voynet. Il était explosif mais n’avait pas été exploité. Vous savez, en dix ans, j’ai connu six ministres de l’Environnement au comité local de l’eau.
Qu’avez-vous fait ?
À l’occasion d’un voyage touristique personnel, j’ai été amené à faire des conférences en Guadeloupe en 2005 sur les dangers des pesticides. Des associations voulaient en savoir plus. Depuis deux ans, elles se bagarraient déjà pour avoir une enquête. Elles avaient déposé plainte pour empoisonnement mais leur avocat avait subi des pressions. Le barreau s’était même mis en grève pour soutenir cet avocat. Mais le procureur avait retiré sa plainte. C’était l’omerta.
Pourtant, le chlordécone est interdit ?
Depuis 1993 en effet. Des analyses avaient révélé des taux extrêmement élevés dans l’eau. Il avait même fallu fermer une usine d’embouteillage d’eau de source. Des doses effarantes de pesticides ont également été prélevées sur les poissons. Mais les sols étaient déjà largement contaminés. D’ailleurs, en 2002, une cargaison de patates douces polluées en provenance de la Martinique (où la situation est identique) a été interceptée.
Quelles mesures ont été prises ?
Les producteurs locaux sont obligés de demander un prélèvement de leur sol avant la mise en culture. S’ils ne le font pas et que leur récolte est contaminée, ils doivent la détruire à leurs frais. C’est cher et il n’y a pas d’usine pour éliminer cette molécule aux Antilles. Comme les produits continuent à circuler, a été instauré un seuil de contamination pour des produits courants (1). L’Afssa (2) conseille à ceux qui ont un petit jardin créole de ne pas manger d’ignames plus de deux fois par semaine.
Quelles sont les conséquences du chlordécone sur la santé ?
On parle d’un taux majeur de cancers de la prostate. Des soupçons pèsent aussi sur certaines atteintes génétiques et neurologiques. Il y aurait une forme atypique de la maladie de Parkinson.
Que faire, alors ?
Il faut trouver des méthodes de dépollution des sols car le chlordécone est là pour longtemps. Des analyses très fines des sols sont nécessaires pour pouvoir planter sur ces terrains pollués autre chose que des produits de grande consommation. Il faut que la France mette les moyens car trop de producteurs et d’habitants des Antilles sont dans la détresse. (1) Dachine, patate douce, igname, concombre, carotte, tomate, melon, poulet. (2) Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

